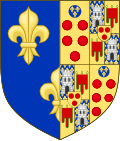Top Qs
Chronologie
Chat
Contexte
Liste des reines et impératrices de France
page de liste de Wikipédia De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Remove ads
Remove ads
La liste des reines et impératrices de France réunit les conjointes des monarques de France.



La reine de France est l'épouse du roi de France, tandis que l'impératrice des Français est celle de l'empereur des Français. En France, la succession au trône de France est interdite aux femmes depuis les Valois, au XIVe siècle, avec la mise en avant d'une réinterprétation de l'ancienne loi salique : les reines ou impératrices depuis cette époque n'assurent le pouvoir qu'au titre de leurs enfants mineurs, ou lors de l'empêchement de leur mari. En réalité, même avant l'instauration de cette loi, la France n'a jamais connu de souveraine de plein droit.
- Pour leur conjoint, voir Liste des monarques de France
- Pour les épouses des héritiers au trône de France, voir Liste des dauphines de France
Remove ads
Évolution de la titulature
Résumé
Contexte
Le titre porté par l'épouse du monarque a peu évolué durant l'histoire. Originellement, le titre latin est le pendant féminin de rex Francorum, soit regina Francorum, que l'on peut traduire par reine des Francs. À partir du XIIIe siècle, le titre latin est plus couramment regina Franciae, littéralement reine de France, bien que le titre ancien ait cours jusqu'à la Révolution. Les reines de France ont également porté le titre de reine de Navarre, notamment entre 1285 et 1328 et entre 1589 et 1791. De 1791 à 1792 et de 1830 à 1848, le titre de reine de France s'est transformé en reine des Français. Enfin, sous le Premier Empire et le Second Empire, elle portait le titre d'impératrice des Français.
Au total, on dénombre 93 reines et 3 impératrices de 465 à 1871. La première épouse d'un monarque français étant Basine de Thuringe et la dernière Eugénie de Montijo.
Le cas de la régence
Les reines ou impératrices n’avaient aucune vocation à régner, excepté dans des cas particuliers de régence — n’étant pas l’expression d’un pouvoir intuitu personæ, qui leur aurait été propre, puisqu’elles ne pouvaient gouverner qu’en lieu et place du roi et temporairement — ou dans des cas plus anciens (Brunehaut, Frédégonde, , etc.).
Le cas d'une régence exercée par la reine s'est présenté plusieurs fois dans l'histoire du Royaume, soit en raison du départ du roi à la guerre, soit en raison de la minorité du roi. Plusieurs souveraines ont ainsi marqué l'histoire du pays à travers l'exercice de la régence et parfois l'exercice du pouvoir au-delà, comme Catherine de Médicis ou encore Anne d'Autriche. Lors d'une régence, la reine est alors appelée régente de France.
Remove ads
Rôle
Résumé
Contexte
Choix de la reine
Le choix de la reine évolue au travers des siècles, en rapport avec son rôle et ses fonctions. Durant le règne mérovingien, le statut de la femme n'est pas une obligation pour l'union au roi. Caribert Ier est par exemple déjà marié à Ingeberge et s'unit également à deux sœurs, Marcovèfe et Méroflède, filles d'ouvrier. Il épouse également Théodechilde, fille de berger. Si les cas sont nombreux, ils n'empêchent pas les unions de très haut rang[1].
Avec les Carolingiens, la monogamie est obligatoire et les critères du choix d'une reine changent. Seules les filles de grands seigneurs, de princes ou de rois sont dignes d'épouser les rois Francs. Au sein de la dynastie capétienne, le choix de l'épouse des héritiers est défini par le souverain en place et jouent un rôle important dans les relations diplomatiques[2].
Place et rôle de la reine
Le rôle de la reine est complexe à déterminer à l'époque mérovingienne. Elle possède probablement des attributions particulières et une influence au sein de la sphère politique. Avec l'influence de l'Église et la mise en place de la monogamie, ses fonctions se dessinent mieux. Chez les Carolingiens, la reine participe à la vie publique, possède sa propre maison, ses serviteurs et son personnel. Elle a des attributions économiques et assurent la gestion générale du palais. Elle a également la charge de l'éducation des enfants ainsi que du choix de leurs époux et épouses[3].
Au XVIe siècle, la reine jouit de nombreux privilèges et de prérogatives. Elle possède sa propre chapelle, son sceau et de nombreux privilèges fiscaux : droit de gîte, droit de prises et de réquisition, droit de crédit, droit de délivrer des lettres de maîtrise, droit de rachat des domaines aliénés. De plus, dans le domaine spirituel, elle ne peut être excommuniée que par bulle pontificale[4].
Les reines étendent également leur influence dans le domaine de la culture et de l'éducation, ainsi que dans le domaine des arts. Ces différents choix d'influence dépendent quant à eux des ambitions personnelles de chaque reine[5].
Remove ads
Liste des reines et impératrices de France
Résumé
Contexte
Mérovingiens
Carolingiens (751-887)
Robertiens (888-898)
Carolingiens (898-922)
Robertiens (922-923)
Robertiens/Bosonides (923-936)
Carolingiens (936-987)
Capétiens
Capétiens directs (branche aînée)
Valois
Bourbon
Bonaparte (Premier Empire et Cent-Jours)
Bourbon (Seconde Restauration)
Louis XVIII et Charles X étaient veufs lors de leur règne.
Orléans (Monarchie de Juillet)
Bonaparte (Second Empire)
Remove ads
Le cas de Madame de Maintenon

Le cas de Madame de Maintenon (1635-1719), née Françoise d'Aubigné, est ambigu. Devenu veuf de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, Louis XIV l'épouse secrètement, le et elle demeura 32 ans à ses côtés. Elle n'était pas de haut lignage, même si son grand-père Théodore Agrippa d'Aubigné était un ami de jeunesse du roi Henri IV, grand-père de Louis XIV. Elle n'a jamais porté le titre de reine, puisqu’épouse secrète[10], tout en jouissant de certains privilèges à la Cour analogues à ceux d'une reine de France (ex. : lorsqu'elle se déplaçait en chaise à porteurs, les princesses devaient suivre immédiatement derrière, selon les us et coutumes à la cour de Versailles, mais elle ne pouvait cependant assister à aucun grand cérémonial d’État[11]).
Remove ads
Le cas de Marie-Thérèse de France

Le cas de la dernière dauphine de France, née Marie-Thérèse de France, est ambigu. Mariée à son cousin germain Louis Antoine d'Artois le 9 juin 1799, elle devient dauphine de France le 16 septembre 1824 lorsque son beau-père accède au trône. En 1830, une révolution chasse le roi de la capitale, cherchant à sauver son trône, Charles X abdique en faveur de son petit-fils le duc de Bordeaux. Cependant, le dauphin met une vingtaine de minutes avant de contresigner l'abdication. Selon certains juristes, néanmoins, ce dernier fut roi durant ce court laps de temps ; au contraire, d'autres ne reconnaissent pas l'abdication, contraire aux Lois fondamentales du royaume. On remarquera que le comte de Chambord laissera toujours la première place à sa tante, même lorsque cette dernière deviendra veuve en 1844[12].
Remove ads
Notes et références
Annexes
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads