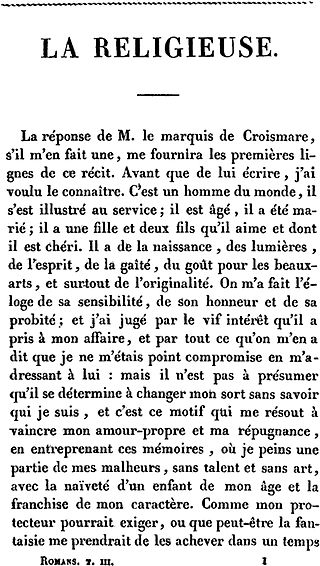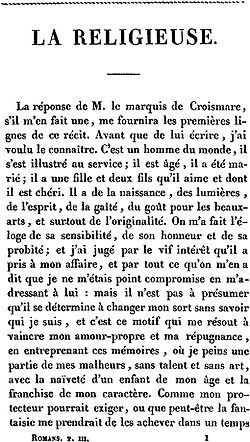Top Qs
Chronologie
Chat
Contexte
La Religieuse
livre de Denis Diderot De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Remove ads
La Religieuse est un roman-mémoires de Denis Diderot achevé vers 1780 et publié à titre posthume en 1796. Inspiré d'une histoire réelle, celle de Marguerite Delamarre, ce roman raconte comment une jeune fille est devenue religieuse contre son gré et a dû se battre pour échapper à la clôture et recouvrer la liberté.
Remove ads
Contexte
Résumé
Contexte
En 1760, Diderot commence à composer ce roman à partir d'une mystification. Pour faire revenir à Paris leur ami le marquis de Croismare, Diderot et quelques amis s'inspirent de faits réels et imaginent les lettres d'une religieuse sollicitant l'aide du marquis pour s'extraire du cloître où elle est retenue malgré elle. C'est en développant ces lettres que Diderot commence à composer le roman qui deviendra La Religieuse, sans toutefois achever le texte[1].
Grimm rappelle ce complot dans la Correspondance littéraire en 1770 ; son témoignage est désormais connu sous le nom de « préface-annexe » et intégré aux publications du roman depuis la fin du XVIIIe siècle. Son statut hybride entre réalité et prolongement de la mystification a été largement commenté par les historiens de la littérature. Jean Cartrysse par exemple considère que
« La Religieuse est l'aboutissement romanesque d'une mystification dont l'intrigue a été postérieurement incorporée au récit sous forme de préface-annexe[2]. »
Diderot reprend l'écriture de son roman en 1780, achève un état du texte et le laissera immédiatement diffuser en feuilleton dans la Correspondance littéraire, philosophique et critique entre 1780 et 1782. Le roman paraît sous forme imprimée en 1796, à titre posthume.
Remove ads
Sources
La base du roman est donc le corpus de lettres échangées par le groupe d'amis et Croismare. Cette mystification est elle-même inspirée de l'histoire bien réelle d’une religieuse de l'abbaye royale de Longchamp nommée Marguerite Delamarre, qui avait fait parler d’elle dans les salons en 1758 pour avoir écrit à la justice, demandant d’être libérée du cloître où ses parents l’avaient enfermée. Elle affirmait être une enfant illégitime et que, de peur d’aller en enfer, sa mère, par un chantage affectif, l'aurait persuadée d’aller dans ce couvent. Mais sa mère s'y oppose afin de ne pas avoir à lui restituer une part de son héritage[3].
Diderot a également pu intégrer à son roman des éléments de la vie de sa propre sœur Angélique. Née en 1720, elle est entrée chez les Ursulines de Langres et y est morte folle en 1748. Pour Marie-Angélique de Vandeul, fille de Denis Diderot, sa tante était morte d'épuisement[4].
René Godenne a signalé diverses sources littéraires antérieures, telle La Religieuse malgré elle de Brunet de Brou[5].
Remove ads
Résumé
Résumé
Contexte
Au XVIIIe siècle, Suzanne Simonin est contrainte par ses parents de prononcer ses vœux au terme de son noviciat. En effet, pour des raisons de dots qui pénaliseraient ses deux sœurs, ceux-ci ont préféré enfermer leur fille au couvent. En réalité, Suzanne est une enfant illégitime et sa mère espère, en l'écartant, expier sa faute de jeunesse.
C’est dans la communauté des Clarisses de Longchamp qu’elle rencontre la sœur supérieure Mme de Moni. Celle-ci, une mystique, se lie d’amitié avec la jeune fille avant de mourir. La période de bonheur et de plénitude s’achève pour l’héroïne avec l’arrivée d’une nouvelle supérieure : Sainte-Christine. Sachant que Suzanne désire rompre ses vœux et que, pour ce faire, elle a intenté un procès à la communauté, la supérieure met en œuvre un harcèlement moral et physique sur Suzanne. L'infortunée subit de l’ensemble de la communauté, à l’instigation de la supérieure, une multitude d’humiliations physiques et morales. En perdant son procès, Suzanne est condamnée à rester au couvent. Cependant son avocat, Maître Manouri, touché par sa détresse, obtient son transfert au couvent Saint-Eutrope.
Au terme de son calvaire, Suzanne pardonne à ses bourreaux tout en continuant à poursuivre ses réflexions éminemment subversives sur le bien-fondé des cloîtres et de l’univers conventuel. Son arrivée dans la communauté de Saint-Eutrope marque le début de l’épisode le plus fameux de La Religieuse. En effet, cette période est caractérisée par l’entreprise de séduction de la supérieure à son égard. Celle-ci sombre dans la folie devant l’indifférence et l’innocence de la chaste Suzanne. Consciente de la dangerosité de désirs pervers qu’elle ne peut refouler, la supérieure se livre aux lacérations et au jeûne avant de mourir démente.
Incapable de rester plus longtemps cloîtrée, Suzanne réussit à s’enfuir du couvent. Dans une conclusion à peine esquissée, l’auteur nous fait comprendre que Suzanne, dans la clandestinité, attend l’aide du marquis de Croismare et vit dans la peur d’être reprise.
Remove ads
Évaluation
Selon Raymond Trousson, « Diderot a su faire de son héroïne, non la représentation d'une idée, mais un personnage attachant et pathétique, même si son innocence et son ignorance, nécessaires au récit, n'emportent pas toujours la conviction[6]. » La Religieuse est une ode à la liberté de choisir son destin. L’aliénation religieuse créée par l’univers conventuel y est dénoncée de manière polémique. Diderot prête sa voix et ses idées sur le couvent à Suzanne, qui, contrairement à l’auteur, est une croyante convaincue.
Diderot fait le procès des institutions religieuses coercitives, contraires à la véritable religion dans la mesure où elles mènent les individus aux souffrances terrestres et à la damnation éternelle. Le monde clos entraîne la dégradation de la nature humaine. Oisiveté, inutilité sociale, promiscuité plongent peu à peu les reclus dans des rêveries morbides ou mystiques, puis dans la folie et les mènent parfois au suicide.
Remove ads
Éditions
Éditions commentées, scientifiques ou critiques
- Diderot, Œuvres complètes, tome XI, Paris, Hermann, coll. dite DPV (ISBN 2705658025).
- Robert Mauzi (éd.), Paris, Gallimard, 1972, coll. « Folio ».
- Florence Lotterie (éd.), Paris, Flammarion, 2009, GF no 1394 (ISBN 978-2-0812-0821-6).
- Christophe Martin, Diderot. La Religieuse, Paris, Gallimard, coll. « Foliothèque », 2010 (ISBN 978-2-07-039654-2).
Livre audio
- Denis Diderot (auteur) et Séverine Desbordes (narratrice), La Religieuse, La Bazoge, CdL éditions, (ISBN 978-2-35383-044-2). Support : 6 disques compacts audio ; durée : environ 7 h.
Réédition au format MP3. Support : 1 disque compact audio MP3 ; durée : environ 7 h ; 21 avril 2008 (ISBN 978-2-35383-045-9).
Remove ads
Adaptations
Cinéma
- 1967 : Suzanne Simonin, la Religieuse de Diderot de Jacques Rivette avec Anna Karina (censuré à sa sortie[7]).
- 2013 : La Religieuse de Guillaume Nicloux avec Pauline Étienne.
Théâtre
- 1960 : adaptation de Roland Monod, au Théâtre Quotidien de Marseille.
- 2011 : Les Vœux de la religieuse, adaptation de Florence Camoin, théâtre de Saint-Maur[8].
- 2012 : adaptation d'Anne Théron, au théâtre Monfort, à Paris.
- 2013 : adaptation de Nicolas Vaude, au théâtre Le Ranelagh, à Paris.
- 2017 : adaptation d'Anaïs Gabay, au théâtre Pixel, à Avignon (pendant la période du festival).
Remove ads
Notes et références
Voir aussi
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads