trouble psychologique De Wikipédia, l'encyclopédie libre
L'addiction à la télévision (ou dépendance à la télévision) est un trouble psychologique (pathologie communicationnelle et addiction comportementale) entraînant chez certains téléspectateurs un besoin répétitif et compulsif (incontrôlable, voire obsessionnel) de regarder la télévision, au point que cette activité empiète et interfère négativement avec leur vie quotidienne, professionnelle ou affective.

La personne concernée peut alors développer une anxiété ou une dépression[1] (qui vont éventuellement indirectement aussi affecter son entourage).
En 1990, bien que le petit écran fût déjà régulièrement ou périodiquement regardé par plus d'un milliard de personnes, et que 65 à 70 % des Américains sondés estimaient que la télévision est addictive, et en dépit de nombreux rapports concernant l'addiction à la télévision, peu d'études empiriques (basées sur l'expérience) et larges avaient déjà porté sur la question[2]. De nombreux parallèles ont été faits avec d'autres formes de dépendance comportementale, comme la dépendance à la drogue ou au jeu.
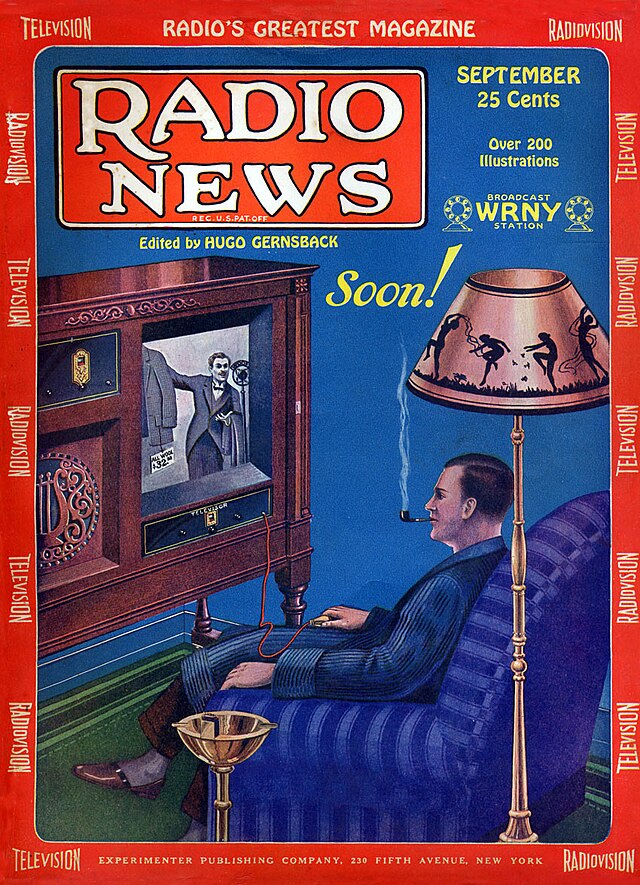






Pour Goodman (1990) l'addiction est un phénomène polymorphe que l'on peut décrire comme « processus par lequel un comportement, qui peut fonctionner à la fois pour produire du plaisir et pour soulager un malaise intérieur, est utilisé sous un mode caractérisé par 1) l’échec répété dans le contrôle de ce comportement et 2) la persistance de ce comportement en dépit de conséquences négatives significatives ».
En 1997, JF Sarpi se demande si la télévision est une drogue dure ou une drogue douce[8].
Dans les années 1980-1990, des psychologues spécialistes des psychotropes étudient les facteurs psychologiques de cette toxicomanie sans produit ; R McIlwraith & al. proposent propose par exemple en 1991 quatre modèles théoriques expliquant cette addiction, basés 1) sur les effets de la télévision sur l'imagination et la fantaisie de la vie, 2) sur le niveau d'excitation procuré par la télévision, 3) sur une personnalité déjà vulnérable à l'addiction et 4) un schéma particulier d'utilisations/gratifications propre au médium qu'est le téléviseur[2].
Selon les données disponibles, le téléviseur peut dans un premier temps effectivement détendre et distraire le téléspectateur et diminuer certains états négatif, mais pour cette raison, nombre de téléspectateurs peuvent peu à peu devenir dépendant du médium et l'utiliser à l'excès, avec des inconvénients qui vont peu à peu dépasser les avantages[2].
Ce phénomène est parfois classé parmi les nouvelles addictions, mais selon McIlwraith ce n'est pas l'addiction, mais sa forme et plus précisément « les moyens hédoniques mis en jeu » qui sont nouveaux (téléviseur, télécommande).
McIlwraith et ses collègues, en 1991 se demande si une telle utilisation de la télévision (comme modulateur d'affects) est ou non un obstacle important à l'apprentissage fonctionnel. (Base de données PsycINFO Record (c) 2012 APA, tous droits réservés)[2]
Il est cependant largement reconnu comme un réel problème pour de nombreux téléspectateurs[9].
En 2004, C Horvath (2004) estimait que la Recherche devait encore définir les paramètres permettant de différencier un comportement normal face à la télévision d'un comportement réellement addictif[10]
La dépendance à la télévision ne figure pas parmi les maladies officiellement recensées dans les guides de diagnostic médical, par exemple par le DSM-IV[11].
Les bébés[12], les jeunes enfants[13] (téléphagie infantile) et les personnes âgées[14] semblent vulnérables à cette dépendance. Chez les étudiants, les garçons y semblent un peu plus vulnérables que les filles (selon Greenberg & al. (1999)[15].
Plusieurs phénomènes sont souvent associés :
Du point de vue de la psychologie hédonique, parmi les troubles de la gestion hédonique (c'est-à-dire dans « ce que fait un être humain, chaque jour et à chaque instant, pour réguler ces états psychologiques »[18]), Loonis classe en 2002[18] l'addiction à la télévision parmi les stimulations psychiques exogènes, les 2 autres catégories possibles pour lui étant *1°) les stimulations psychiques endogènes (réflexions intellectuelles, rêveries, fantasmes érotiques...)
Malgré leur diversité, chacune de ces classes pourraient avoir un dénominateur neurologique commun, comme le montrent l'existence de production de drogues endogènes par les systèmes cérébraux de récompense ou de lutte contre certains stress. La vision et l'ouïe comptent parmi les moyens importants de découverte de l'environnement par le jeune enfant, ce qui pourrait expliquer à quel point ils peuvent être fasciné par l'image animée et en particulier le dessin animé.
Une des compositions de l'addiction à la télévision peut être l'addiction aux images[19]
La fascination pour l'image, le spectacle et les symboles est ancienne, et fut notamment utilisée par le système panem et circenses mis en place par l'empire romain[4].
La télévision est un « média de masse » qui offre une gratification immédiate et temporellement apparemment infinie aux téléspectateurs. Celui-ci peut alors rester totalement passif, avec l'illusion de vivre une communication sociale (On lui parle, on lui montre, on le fait rire ou pleurer, on le cultive, mais cette communication est à sens unique, à la différence de l'Internet dans le cas du Web 2.0).
Certaines enquêtes montrent que le petit écran serait l’un des loisirs les plus frustrants pour l'individu qu'est le téléspectateur lui-même. La corrélation entre le nombre d’heures passées devant le téléviseur et les indices de satisfaction est négative. Selon Robert Putnam, comme toute consommation compulsive ou addictive, la télévision est une activité étonnamment peu valorisante[20].
Les enjeux sont notamment commerciaux, socioculturels et éthiques, mais aussi de santé publique.
Dans un paysage très concurrentiel où le nombre de chaines ne cesse de croître, et où l'on veut fidéliser le téléspectateur, et où l'industrie des programmes dits culturels vend du temps de cerveau disponible aux publicitaires, cette industrie pourrait (sciemment et/ou inconsciemment) faciliter ou encourager l'addiction des spectateurs[21].
Selon les données scientifiques disponibles, la télévision :
Cette dépendance se résout parfois d'elle-même, et dans ce cas, à la différence des dépendances chimiques elle n’entraînerait pas ou peu de séquelles physiques et psychiques pour la santé, affirmation que seules des études épidémiologiques de long terme pourront confirmer.
Elle semble en régression dans certains pays où elle semble alors souvent remplacée par une addiction à l'internet ou au smartphone qui touche également beaucoup les jeunes.
Avec l'apparition de la télévision numérique, en relief ou en grand écran (contexte plus immersif[27]), ou avec sa consultation via l'internet sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone, cette forme d'addiction pourrait évoluer, en prenant moins d'importance grâce à une moindre passivité du spectateur ou peut-être en devenant l'une des composantes de la cyberaddiction (dépendance à Internet) dans le cadre du nomadisme numérique.
Il est probable que dans un certain nombre de cas, la télévision a simplement été le révélateur d'une vulnérabilité à l'addiction, qui aurait pu sans elle avoir d'autres cibles.
Des chercheurs (tel Horvath en 2004[28]) se sont inspirés de grilles utilisées dans d'autres domaines de la psychologie des addictions (ex : addiction au tabac ou à l'alcool) pour proposer de moyens de mesurer quantitativement et qualitativement l'addiction à la télévision.
Parmi les recommandations les plus souvent citées, figurent les moyens suivants :
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.